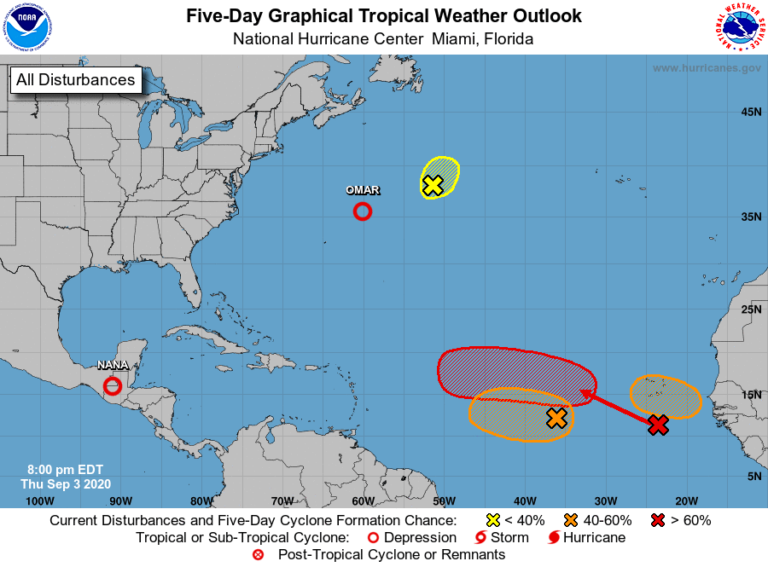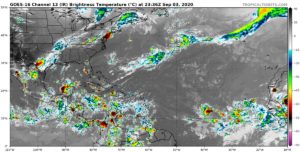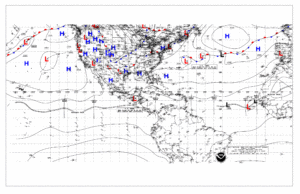Annie Cordy est morte ce vendredi, à l’âge de 92 ans. Populaire et rigolote, dotée d’une force de travail spectaculaire, Annie Cordy ne fut pas seulement l’interprète de “Tata Yoyo” et de “La Bonne du curé”. Artiste complète – chanteuse, danseuse, actrice –, elle aimait se définir comme une saltimbanque et jouer sur tous les registres, du cinéma d’auteur au music-hall.
Elle aura tout fait, tout joué : des opérettes, des films, des sketchs, des rôles tragiques et des claquettes, des chansons douces, des farces et du french cancan. Pimpante, souriante, fantaisiste, Annie Cordy, née Léonie Cooreman, décida très jeune de consacrer sa vie à l’art de divertir.
Née en Belgique wallonne dans une famille modeste et heureuse – père ébéniste, mère épicière –, Annie Cordy a tout juste 18 ans au sortir de la guerre. Et d’emblée, elle monte sur les planches : elle démarre comme meneuse de revue au Bœuf sur le toit, à Bruxelles ; elle est vite débauchée par les patrons du Lido puis du Moulin-Rouge, à Paris. C’est là qu’elle rencontre son imprésario, François-Henri Bruneau, dit Bruno, qu’elle épouse quelques années plus tard et qui sera son seul amour. Démarrage en fanfare.
Bourvil, Jean-Pierre Cassel, Darry Cowl, Luis Mariano…
Car rapidement, elle va s’imposer comme une chanteuse de premier plan. Au début des années 1950, Annie Cordy enregistre ses premiers grands succès Les Trois Bandits de Napoli, Bonbons caramels, Fleur de papillon, Léon, Tantina de Burgos, La Ballade de Davy Crockett… La jeune femme aime rire, et sur les plateaux de cinéma, elle se lie avec ceux qui deviendront ses meilleurs amis : Bourvil, Jean-Pierre Cassel, Darry Cowl, et surtout Luis Mariano. Après un film de Sacha Guitry (Si Versailles m’était conté) en 1953, elle joue, entre autres, dans Poisson d’avril, avec Bourvil et Louis de Funès (1954) et Bonjour sourire !, avec Henri Salvador (1955).
Le succès du film Le Chanteur de Mexico, en 1956, avec Luis Mariano et Bourvil, la fait même repérer jusqu’aux Etats-Unis. Après une tournée réussie, Hollywood lui propose un contrat ; mais son mari s’oppose à cette carrière américaine. Motif : on mange trop mal, dans ce pays ! « J’aimais mon mari, c’est normal, alors je l’ai suivi et je suis revenue à Paris », racontera-t-elle dans ses Mémoires.
Tant pis pour l’Amérique, la France ne la lâche pas. Jamais à la mode, mais toujours populaire, Annie Cordy résiste à la déferlante yéyé, qui fit sombrer tant d’autres artistes de sa génération. Elle traverse les années 1960 en assurant de copieuses tournées à travers tout le pays : « Je ne suis pas mondaine, ni parisienne, dit-elle au Figaro, en 2005. Je suis une saltimbanque, ravie d’être toujours sur les routes, prête à faire mon métier par tous les temps, dans tous les lieux, à toutes les sauces. »
Le goût du divertissement
Ce « petit clown du music-hall », surnom qu’on lui donne parfois, excelle dans l’art de faire le pitre. Toujours partante pour le hula-hoop, le yoyo, le kazoo. Pour se déguiser en cafetière, porter un nez qui s’allume, des plumes dans les cheveux, des chapeaux ridicules et des tresses qui se dressent toutes seules, Annie Cordy a incontestablement le goût du divertissement. Sans complexe, elle ose grimacer, adopter des postures grotesques, sautiller, se désarticuler. « Il faut donner au public ce qu’il est venu voir, en l’occurrence de la bonne humeur. Il a assez à faire de ses soucis pour prendre les miens en charge », se justifie-t-elle en 2006 lors d’une interview au Progrès.
Plus de trente ans plus tôt, en 1974, elle s’était parfaitement acquitée de sa tâche en interprétant, en petit tablier blanc, La Bonne du curé, personnage de bretonne délurée et bébête, dont les paroles sont devenues cultes : « J’voudrais bien mais j’peux point… » Enorme tube : trois millions d’exemplaires vendus.
A réécouter sa prolifique discographie – sept cents titres enregistrés, deux mille interprétés ! –, on repère un penchant pour les chansons-onomatopées : Cho Ka Ka O, Frida oum papa, Hop Digui Di, Oh la la!, Ouah ouah!, Cha ba di, Nick nack paddy whack, Cot cot coin coin, Tu tu tu, Oh yé !, et bien sûr… Tata Yoyo ! L’une de ses plus grosses ventes de disques, en 1981. Moins anecdotique qu’elle y paraît, car elle ajoute une corde à l’arc de la chanteuse : outre son grand chapeau, sa Tata Yoyo porte un « grand boa, une robe à fleurs et des faux cils »… et voilà comment Annie Cordy devint une icône second degré de la culture gay.
Cinéma, théâtre, comédies musicales…
Ses succès populaires et comiques ne dissuadent pas les cinéastes de lui confier des rôles tragiques. En 1970, Annie Cordy joue dans Le Passager de la pluie, de René Clément, et dans La Rupture, de Claude Chabrol. Mais c’est l’année suivante qu’elle décroche l’un de ses rôles les plus marquants : aux côtés de Simone Signoret et de Jean Gabin, dans Le Chat, de Pierre Granier-Deferre ; elle y incarne la patronne d’un hôtel de passe parisien où Gabin vient se réfugier après que sa femme (Simone Signoret) a tué son chat… On la reconnaît à peine, tant son interprétation, sobre, tout en retenue, sans un sourire, tranche avec son énergie habituelle.
Jean Gabin et Annie Cordy dans Le Chat, de Pierre Granier-Deferre, 1971.
Lira Films - Unitas
Autre style mais même reconnaissance : en 1972, elle triomphe dans Hello Dolly !, adaptation française du musical américain – côté comédies musicales, il y aura encore Nini la chance (1976) et Envoyez la musique ! (1982). La comédie lui va décidément bien. Car dans les années 190, elle brille encore au théâtre, dans le rôle de Madame Sans-Gêne, ancienne blanchisseuse promue duchesse, se montrant ainsi l’égale de ses illustres prédécesseures dans ce rôle – Mistinguett, Arletty et Jacqueline Maillan.
En 2015, dans le film Les Souvenirs, de Jean-Paul Rouve, elle se révèle bouleversante en grand-mère rebelle, qui s’évade de la maison de retraite où elle ne supporte pas d’être enfermée. A ces grands rôles s’ajoute une quantité impressionnante de participations à des téléfilms, doublages, séries, et même des publicités (« Javel Dose, la Javel sans l’eau, c’est grandiose ! ») : l’hyperactive Cordy ne s’arrête jamais ! Elle prétend, ne plaisantant qu’à moitié, qu’elle a plus souvent vécu dans sa voiture que dans sa propre maison…
La baronne Annie Cordy
Anoblie par le roi des Belges, Albert II, en 2004, la baronne Annie Cordy se choisit pour devise : « La passion fait la force ». D’une condition physique impressionnante – à 80 ans, elle pouvait toujours mettre sa jambe derrière sa tête –, elle continua jusqu’au bout d’accepter les invitations des plateaux de télévision, des galas de charité, de remplir les salles d’un bout à l’autre de la France. « Je suis tellement occupée que, quand je serai morte, je ne m’en rendrai même pas compte ! » plaisantait-elle dans Paris Match, en 2015.
Ces dernières années, quand on lui demandait ce qu’elle regrettait le plus, elle répondait invariablement : « De ne pas avoir fait d’études, bien plus que de ne pas avoir eu d’enfant. » Et sa plus grande fierté ? « D’avoir touché le plus grand nombre et d’avoir rendu les gens heureux. » C’est bien ce qui compte, non ?